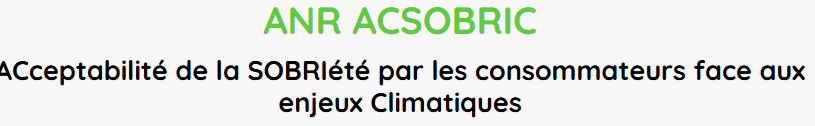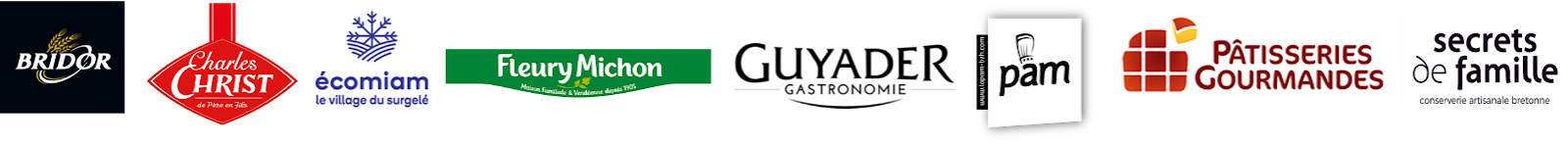MANITRANS

Pilotage de projet
- Université Bretagne Occidentale
Responsable de projet
- Gontier Camille MCF
Équipe projet
- Camille Gontier
- Anne Renoux
- Nicolas Le Corre
- Léna Gruas
- Sylvaine Derycke
- Thierry Michot
- Lucie Rey
- Jérôme Fouilleul
- Hugo Bourbillères (Rennes 2)
- Yohann Rech (Rennes 2)
- Pim Vershuuren (Rennes 2).
Contact projet
Camille Gontier
camille.gontier@univ-brest.fr
Durée
36 mois
Budget
165 559 € HT
Projet financé par

Partenaires

MANITRANS
Manifestations sportives et culturelles dans les aires protégées : de nouvelles méthodes et des solutions innovantes pour accélérer la transition écologique
Le projet
|
Depuis quelques années, les manifestations sportives et culturelles connaissent un engouement sans précédent dans les espaces naturels protégés (ENP), notamment en région Bretagne. D’une grande diversité de tailles et de formats, ces dernières sont porteuses d’enjeux économiques, socioculturels, territoriaux mais aussi environnementaux, ayant lieu dans des espaces jugés sensibles du point de vue de la biodiversité. Comment alors concilier une demande sociale forte avec des objectifs de conservation ? S’inscrivant dans la dynamique collective initiée par l’Agence Bretonne de la Biodiversité et ses partenaires, le projet MANITRANS vise à répondre à ce questionnement et à développer des solutions permettant la transformation des manifestations en réunissant des acteurs en charge de la gestion des ENP et une équipe de recherche pluridisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales (laboratoires LEGO, LETG, CRBC et LABERS à l’UBO et VIPS de l’Université de Rennes 2). MANITRANS est un projet de recherche-action qui s’inscrit dans les paradigmes des sciences sociales de la conservation, de la sociologie des politiques environnementales et de la sociologie des organisations. Il questionne et vise à renforcer la capacité des organisateurs de manifestations et de toutes les parties prenantes (collectivités locales, membres et bénévoles des organisations sollicitées, partenaires publics et privés, services institutionnels, presse, etc.) à intégrer dans la conception et l’organisation et des événements, les impacts directs et indirects que ces derniers peuvent générer sur les espaces naturels et leur biodiversité (dégradation et pollution des habitats, dérangement d’espèces, impacts paysagers…). En sélectionnant des manifestations traversant des ENP terrestres, littoraux et marins, le projet va s’intéresser à l’ensemble des pratiques et des dispositifs réglementaires, organisationnels et institutionnels en matière d’impacts environnementaux. Privilégiant une approche qualitative et ethnographique, le projet s’attache à comprendre la façon dont ces impacts sont identifiés, perçus et représentés et la manière dont ils sont intégrés à la conception de la manifestation. Sans présager des premières observations, il s’agit ainsi de mesurer la convergence ou l’écart entre les discours des acteurs, les prises de position des organisateurs et les pratiques objectives. Les résultats attendus permettront d’accompagner les acteurs concernés dans une transition opérationnelle active et efficiente et ces travaux alimenteront la démarche Sinapce portée par l’OFB. |
Objectifs
|
S’inscrivant dans la thématique « Fréquentation de l’espace », le projet vise d’abord à dresser un état des lieux des pratiques et dispositifs réglementaires, organisationnels et institutionnels en matière d’impacts environnementaux. On s’attachera notamment à montrer la façon dont ces impacts sont identifiés, perçus et représentés et, le cas échéant, la façon dont ils sont intégrés à la conception de la manifestation. Sans présager des premières observations, il s’agira aussi de mesurer la convergence ou l’écart entre les discours des organisateurs et les pratiques qui déterminent la manifestation. Dans le même temps, le projet vise à transformer significativement et durablement les pratiques organisationnelles des manifestations sportives et culturelles. Il s’inscrit donc dans les objectifs 2, 3 et 4 de l’AMI : – Objectif 2 : « Comprendre le fonctionnement des activités humaines et les évolutions actuelles ou à venir ». MANITRANS doit permettre de dresser un état des lieux objectif des pratiques organisationnelles en termes d’intégration des enjeux environnementaux, notamment ceux liés à la biodiversité. Cet état des lieux vise à questionner les pratiques réelles des organisateurs de manifestations qui se déroulent en aires protégées. Il s’agira aussi de recenser les parties prenantes des manifestations, d’identifier leur rapport aux enjeux environnementaux (perception des contraintes et des leviers) et leurs influences éventuelles sur les organisateurs. – Objectif 3 : « Etudier les facteurs de réussite de l’accompagnement des pratiques d’activités humaines vers une meilleure compatibilité avec la biodiversité ». MANITRANS est un projet de recherche action dont un des principaux objectifs est de permettre l’intégration réelle des enjeux de biodiversité dans la conception et l’organisation des manifestations sportives et culturelles. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’identifier les conditions qui permettent l’intégration de ces enjeux. Le projet s’attache donc à : – identifier les facteurs de réussite et les bonnes pratiques d’une manifestation respectueuse des sensibilités écologiques de l’espace naturel. – identifier les contraintes et les freins à l’intégration du paradigme environnemental dans toutes ses dimensions (politique, gouvernabilité, réglementaire, représentations sociales et culturelles, coordination des acteurs privés et institutionnels, etc.). – développer des outils managériaux innovants capables de transformer les pratiques organisationnelles. Ces outils devront avoir un caractère transférable et généralisable. – Objectif 4 : « Identifier les conditions nécessaires et construire les outils adaptés au succès des transferts d’expérience ». MANITRANS est un projet construit sur une méthode qualitative mais nous faisons l’hypothèse qu’au-delà des spécificités propres à chaque manifestation, les résultats des enquêtes seront généralisables et transférables à l’échelle nationale dans la mesure où, en France, le contexte économique et institutionnel des événements est relativement homogène. Par l’analyse statistique des données textuelles (discours, document), par le codage des entretiens et par la construction de typologies de manifestations, les résultats pourront être bancarisés et largement diffusés auprès des organisateurs de manifestations, des gestionnaires d’aires protégées, des institutions et des services instructeurs des dossiers.
|
Résultats attendus
|